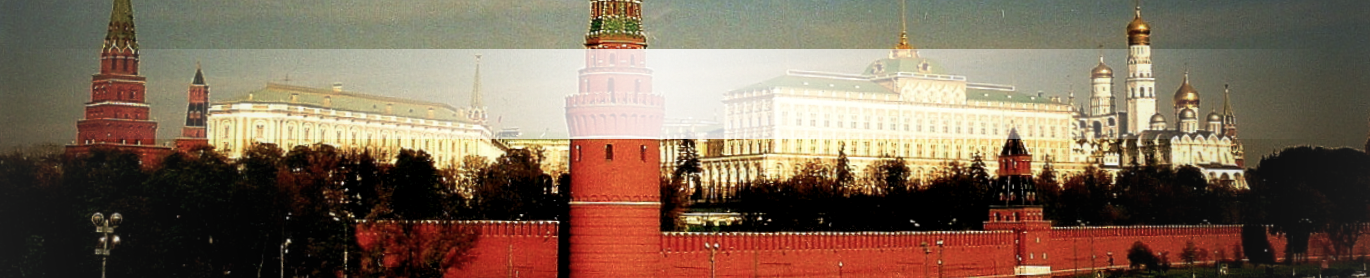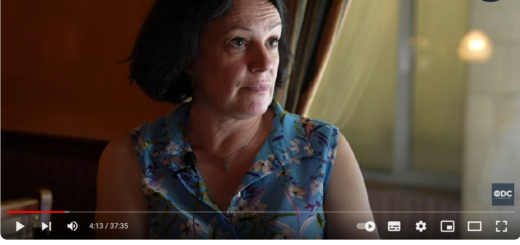Les milieux journalistiques français et l’usine à soumission

Thierry Thodinor revient pour Russie Politics sur le nauffrage des médias en France, en faisant ressortir les mécanismes d’aliénation et de sélection idéologique propres à la profession.
France : une presse sous étroit contrôle idéologique[1]
A mon arrivée dans une grande organisation internationale à Paris, le patron du service de presse était un ancien officier de la CIA, spécialiste des opérations psychologiques, à qui l’on offrait là une pré-retraite confortable. Dans une première vie, vers la fin des années 1960, il avait été l’officier traitant de Daniel Cohn-Bendit, le fameux « héros » du mai 1968 parisien ! Mai 1968 a sans doute été la première révolution de couleur made in USA de l’époque moderne. Et à cet évènement a répondu une révolution dans le monde des médias en France.
Sous de Gaulle, la télévision était aux ordres, mais presse écrite et radios périphériques (extraterritoriales) étaient volontiers critiques. Après mai 68, survient dans la presse installée le déferlement de jeunes journalistes d’extrême-gauche issus des fanzines contestataires. Maoïstes, mais surtout trotskystes dans la meilleure tradition de l’infiltration s’installent au cœur des rédactions. Bientôt, ils domineront les organes de presse de la pensée unique (Denis Olivennes, Serge July, Edwy Plenel, Bernard Henri Levy). Et la plupart finiront chiens de garde d’un néo-conservatisme à la française.
Aujourd’hui, nous sommes pris en tenailles entre l’héritage idéologique de mai 1968 et l’influence toxique de l’argent dans la presse.
Lorsqu’ils avaient encore des lecteurs, les journaux devaient apporter une plus-value en termes d’information et d’investigation.
Aujourd’hui, ces journaux n’existeraient plus sans les subventions publiques et la publicité.
Ils sont devenus la propriété d’une poignée de milliardaires (X. Niel, Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Daniel Kretinski, Dassaut, Bouygues) qui n’en tirent aucun bénéfice immédiat, mais s’offrent une tribune pour acquérir de l’influence. Le passage de l’internationalisme prolétarien au mondialisme marchand n’a posé aucun problème de conscience aux bonnes âmes du journalisme français. Jean-Yves Le Gallou (« La tyrannie médiatique ») parle avec justesse de l’alliance « des trotskystes de salle de rédaction et de la finance internationale. Au fond, poursuit-il, « les uns et les autres sont d’accord sur l’essentiel :
« il faut attaquer tout ce qui s’oppose à leur vision partagée d’un monde de plus en plus liquide – haro sur les frontières, haro sur les cultures et haro sur ceux qui s’opposent à l’avènement du gigantesque espace de marché libéral-libertaire qu’ils appellent de leurs vœux. »
Certes, personne ne lit plus la presse en France :
La Tribune, grand journal économique il y a peu, compte aujourd’hui 600 abonnés. L’Obs en
a à peine 11.000 ! Mais un édito de Libération (lu par quasiment personne et offert dans l’avion) sera repris et commenté par les bienveillants confrères du service public de la radio-TV ce qui donnera un écho à ce non-évènement.
Il y a une logique qui s’est enkystée à l’échelle de l’ensemble du monde occidental :
- Le financeur n’est plus le lecteur, donc place aux préoccupations des élites, qui ont colonisé l’État en vertu du principe : qui paie l’orchestre choisit la musique.
- Et puisque le monde est une marchandise, l’information cède la place à la communication.
Le journalisme comme réalité repose sur certaines règles :
- Présentisme. Foin d’analyse historique !
Un feu roulant d’informations martelées de façon répétitive, sans aucun recul critique et à base de pathos ; l’émotion et l’image sont maîtres à bord. - Un cadre conceptuel unique : inclusivité, féminisme, antiracisme, ethnomasochisme (seuls les russes n’ont pas encore compris que c’est mal d’aimer son pays) … Pour résumer : toutes les armes de destruction massive contre la nation.
- AFP über alles. L’AFP, dont le président est un énarque n’ayant jamais mis les pieds dans une salle de rédaction, forme le fonds unique de l’information des rédactions françaises, qui se contentent pour l’essentiel de bâtonner ses dépêches.
- Pour les plateaux TV-Radio : piocher dans les listes préétablies d’experts autorisés.
La presse française est naufragée économiquement, mais surtout moralement. On peut dire que les journalistes français mentent assez peu dans la mesure où, généralement, ils se contentent de reproduire les mensonges de la presse anglo-saxonne et occultent les nouvelles contrariant le narratif imposé. Sociologiquement, entre l’éditorialiste surpayé (à hauteur de sa bien-pensance) et le deskeur prolétaire, qui bâtonne de la dépêche à la chaîne, rien ou presque.
Le journaliste n’informe plus : il bêle une pensée unique, reproduite à l’identique sur tous les supports, traque et dénonce les déviants, déprime et s’alcoolise pour oublier son insignifiance.
Pour sortir du cadre théorique, passons à un témoignage de première main : celui d’une jeune journaliste ayant successivement travaillé dans tout le spectre médiatique français : presse écrite et audiovisuelle, nationale et régionale. Elle révèle le chemin de croix ordinaire qui attend le journaliste de l’école de journalisme au renoncement final à une carrière dans un milieu professionnel sinistré.
Presse française : le naufrage vu de l’intérieur
L’expérience journalistique varie considérablement selon le type de média, dans lequel on est employé. Le travail d’un journaliste reporter d’images (JRI) en chaine d’informations continues n’est pas le même que celui d’un deskeur en presse écrite ou d’un localier de presse régionale. Toutefois, il y a deux points communs à toutes les expériences en rédaction : les places y sont très chères et la vie d’un pigiste y est infernale.
Les Contrats à Durée Déterminés (CDD) peuvent être très courts (il arrive qu’ils durent moins d’une semaine) ce qui engendre stress permanent et tendance à la soumission. Cela suscite donc une certaine mentalité au sein de la profession : on s’accroche à sa place quoiqu’il en coûte et on tire un trait sur sa vie privée pour conserver un poste aux horaires impossibles.
La carte de presse est le Graal de la profession. Pour l’avoir, il faut un ou deux ans de travail complets. Un an pour les diplômés d’une grande école (ce qui était mon cas) et deux ans pour ceux qui sortent d’une école n’appartenant pas à la « Ivy league » de la profession. Sans carte de presse, les salaires sont minables et on ne vaut pas mieux qu’un vulgaire consommable (crayon ou PQ) aux yeux de la hiérarchie. »
A l’école de journalisme
L’entretien de sélection
J’ai postulé pour l’une des trois « majors » des écoles de journalisme en France (Sciences Po Paris, Centre de Formation des Journalistes également basé à Paris et École Supérieure de Journalisme à Lille).
Mon oral a été assez révélateur de ce qu’ils «craignent» de recevoir comme élève au sein de leur école. Sur mon CV, il était aussi indiqué que j’étais née en Russie et que j’avais la double nationalité. En moyenne, un oral dure une vingtaine de minutes. Le mien durera quarante minutes. Nous sommes en 2015, au moment où la Russie «envahissait» la Crimée.
Résultat, mon oral a très rapidement pris une tournure étrange et sans aucun rapport avec le journalisme. On m’a demandé si je connaissais Alain Soral (un activiste anti-libéral à la réputation sulfureuse) et si j’étais favorable à l’annexion russe de la Crimée. Évidemment, on me «testait», pour voir si j’étais suffisamment maligne pour comprendre qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire. »
Cours de conformisme et pression des pairs
Une fois l’école intégrée, la pression sur les élèves se fait de différentes manières, mais elle est toujours furtive. D’abord, il y a les bulletins semestriels. Chaque professeur doit remplir à la fin d’un semestre son observation sur chaque élève (Une observation sur son travail ET une observation générale, une sorte de note de comportement qui finira dans votre dossier). Il m’est ainsi arrivé que des professeurs signalent par écrit que j’établissais de curieux parallèles entre immigration et délinquance, ce que tout responsable de rédaction (futur employeur) traduira immanquablement par « ennemi d’État » dans le contexte français. On comprend dès lors qu’il vaut mieux se taire pour ne plus avoir ces «tâches» dans nos bulletins. Surtout, nos professeurs ne sont pas de simples professeurs, ce sont souvent des chefs de rédactions (notamment parisiennes) et par conséquent nos futurs employeurs. Si on ne convient pas un prof, nul doute qu’il sera très dur d’avoir un poste au sein de la rédaction où il travaille voire dans l’ensemble de la presse nationale (parisienne), petit milieu fermé où règne l’entre -soi.
A côté des cours « magistraux », il y avait aussi les interventions hebdomadaires de « spécialistes » : un intervenant venait pour nous présenter une thématique sociétale particulière : féminisme, minorités, justice sociale etc. Il s’agit là d’entendre, de la voix d’une personnalité « extérieure » à l’École, comment l’on «doit» penser (pas de débat, LA vérité sur un sujet nous est révélée). Les places en rédaction étant très chères, les kapos les plus enragés sortent des rangs des élèves, qui n’hésitent pas à dénoncer les mal-pensants.
En chaine d’informations
Le métier de JRI (Journaliste Reporter d’Images) est, sur le papier, l’incarnation du rêve journalistique, homme-orchestre chasseur d’images et producteurs de reportages originaux. Dans les faits, les JRI en chaînes d’infos sont surnommés par les autres journalistes les «Recmans» car leur seul boulot consiste à appuyer sur le «Rec» de la caméra une fois envoyés sur le terrain.
L’antenne doit être remplie 24 heures par jour. Corvéables à merci, les «JRI» doivent renoncer à toute vie sociale. Ils travaillent en flux tendu, car le conducteur est prévu à l’avance. Le tout pour gagner péniblement 1100 euros par mois (à Paris !).
En presse écrite
Autre salle autre ambiance dans l’un des plus grands quotidiens français de presse écrite.
Boulot de desk, toute la journée assis à côté de collègues en open space. Toujours pas le temps de creuser les sujets (à cause de la course à l’audience qui implique une cadence importante de publication de papiers).
Comme deskeur, on peut être en relecture, bâtonner de la dépêche ou, très rarement, avoir la journée pour faire un sujet plus fouillé. Des relecteurs relisent les papiers «d’agence». L’agence qui travaillait pour nous était une agence indépendante, qui n’a pas le statut de média ou de service de presse et était spécialisée dans le SEO et les sujets à forte audience. Chaque jour, elle nous envoyait donc une quarantaine de sujets à forte audience potentielle dénichés sur Google Analytics. Les articles étaient livrés clés en main (article et photo) pour publication. Uniquement des sujets à buzz. Les relecteurs relisent également les papiers des journalistes avant publication.
Les articles publiés sont dans 95% des cas des articles des confrères qu’on réécrit. Typiquement, on voit un sujet intéressant chez BFM, on le réécrit en essayant de trouver d’autres sources, de faire un petit mélange et on l’envoie en relecture. Tout le monde fait ça et c’est pourquoi on retrouve les mêmes infos dans 90% des médias. Il y a toutefois des cas où l’on doit passer à côté d’une info pour des raisons opaques. Dans le cas de l’affaire Epstein, consigne a été passée de ne traiter que le strict minimum et d’être le dernier wagon sur cette info.
Comme il y a un horaire de rendu à respecter, on a tendance à ressortir les mêmes experts pour ne pas perdre de temps. On voit donc partout les mêmes « experts » (on sait qu’ils répondent vite, ils connaissent l’exercice, ils sont «de bons clients») à la TV, dans les papiers etc.
En conférence de rédaction, les sujets sont directement tranchés par les chefs de service. Ton sujet c’est poubelle ou validé. Il arrive qu’une nouvelle réunion ait lieu si le sujet d’un papier est sensible. Ainsi, dans le cas d’un papier sur l’impact des sanctions en Russie, la question s’est posée de garder le sujet dans la mesure où les experts expliquaient qu’il n’y avait pas de retombées. Le sujet fut promptement évacué.
Par Thierry Thodinor

[1] Althusser disait de l’idéologie qu’elle est là où les réponses précèdent les questions